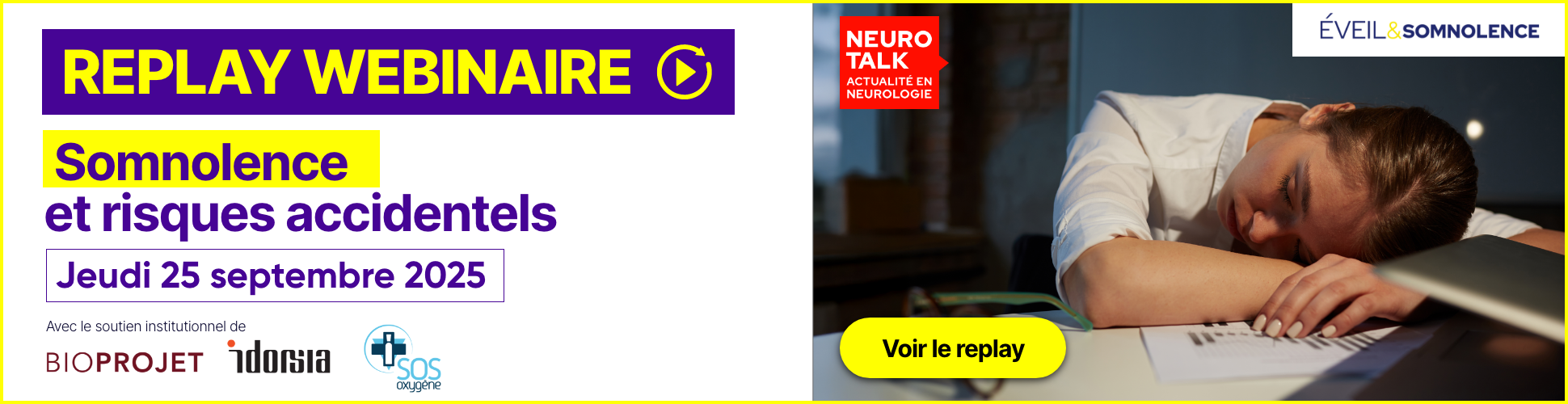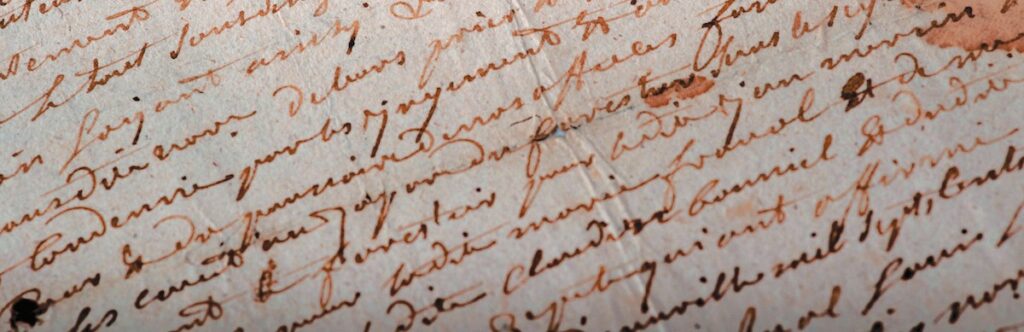
Guillaume Garnier, docteur en Histoire et professeur agrégé à l’Université de Poitiers, est l’auteur d’un livre sur le sommeil, L’Oubli des peines, dans lequel il part à la recherche d’une histoire du sommeil, et de son évolution durant la période pré-industrielle.
LE SOMMEIL PEUT-IL CONSTITUER UN SUJET D’ÉTUDE EN HISTOIRE ?
Le sommeil est un sujet qui s’inscrit en tant qu’objet historique à part entière, car il permet de comprendre la vie des hommes et des femmes d’époques antérieures. Il renseigne, en tant que norme, sur les pratiques et interroge des sujets comme la politique, la religion, les mœurs, l’état d’esprit, etc. Cela permet de réétudier des thèmes qui n’avaient jamais été vus par le prisme de leur rapport au sommeil. Chaque société a donc sa propre culture du sommeil ainsi qu’un rapport différent au sommeil.
DE QUOI DÉPEND-IL ? SUR QUOI INFLUE-T-IL ?
La période pré-industrielle se caractérise par une avancée des sciences, accompagnée par une remise en cause de certains préceptes hérités de l’Antiquité. Un foisonnement intellectuel qui irradie sur la médecine et l’étude du sommeil. D’autant plus qu’à cette époque, on assiste également à une véritable transition dans le quotidien matériel des populations, avec l’arrivée de l’éclairage artificiel. Ce dernier a profondément changé la perception du jour et de la nuit, et par extension du sommeil, et marque une mutation des comportements. À tout cela est lié le début de l’industrialisation qui remet aussi en cause certains préceptes très ancrés ; la nuit, autrefois temps de repos, devient un potentiel temps de travail. C’est une période de processus, entre héritages et nouvelles conceptions.
La religion intervient aussi dans le contrôle des nuits, dédiées au sommeil et au foyer. La période pré-industrielle est donc marquée par un glissement vers la république, la sécularité et la laïcité, une transition du religieux au libéralisme qui libère les nuits.
QUELS SONT LES OUTILS POUR L’ÉTUDIER ?
Textes, traités de médecine, objets, architectures sont les sources qui permettent d’appréhender la culture du sommeil. Mais le sommeil est tellement naturel et universel, qu’il existe peu de sources qui en parlent directement et permettent d’entrer dans le détail.
Pour ma part, je me suis servi de sources littéraires, iconographiques et médicales, mais également de traités de bienséance et de piété qui délivrent des conseils influencés par la vision chrétienne. Les traités de médecine prônaient, tout comme l’Église, un sommeil court (car le sommeil long est synonyme de fainéantise).
Pour explorer l’aspect pratique, les égodocuments, comme les journaux intimes, les lettres, les mémoires, sont très intéressants. Cependant, ce genre de documents ne permet pas d’avoir une idée des habitudes des classes populaires, car ce ne sont pas eux qui écrivaient et étaient publiés.
QU’AVEZ-VOUS APPRIS SUR LE SOMMEIL À VOTRE PÉRIODE D’INTÉRÊT ?
Avant la période pré-industrielle, le sommeil est un bienfait, mais aussi un temps suspect aux yeux des autorités. La nuit, la population doit dormir, car ceux qui ne dorment pas mettent en péril la sécurité de ceux qui dorment. Il y a donc un enjeu de contrôle social sur le sommeil. De plus, pour les normes chrétiennes, la nuit est le temps des tentations, on y rencontre le démon de la foi, les pollutions nocturnes, le libertinage. La nuit est un temps très normé et codifié, comme le quotidien.
Il y a donc une imprégnation très forte des normes sur le sommeil, en tout cas dans les hautes classes de la société. Chez les classes que l’on dit populaires, les archives judiciaires peuvent être une source intéressante. À travers l’analyse des affaires qui s’étaient passées la nuit, des témoignages de personnes entendues pour l’enquête donnaient indirectement des informations sur leur sommeil. Il y a des détails qui ne sont pas anodins « je me suis couché à 22 h », « je me suis réveillé en pleine nuit », « j’étais réveillé depuis 1 h », avec ce travail quantitatif, il y avait cette possibilité de capter une tendance dans les habitudes de sommeil des classes populaires. Grâce à cela j’ai pu déterminer qu’au XVIIIe siècle et une partie du XIXe siècle, on ne se couchait pas forcément à 19-20 h, mais un peu plus tard, et qu’on se levait très tôt en revanche. Le XIXe siècle voit aussi un début d’émancipation, les noctambules veillaient dans les tavernes, l’aristocratie organisaient des fêtes jusqu’au petit matin. Les villes s’illuminent grâce à l’éclairage artificiel, et le changement de culture du sommeil s’opère alors. Le libéralisme ouvre, lui, le travail de nuit pour accroître la productivité.
QUE DIRAIT LA MÉDECINE DE L’HISTOIRE ?
Il serait intéressant d’identifier les troubles du sommeil dans certains récits qui paraissent fantaisistes en première lecture. Pourrait-on revisiter les regards portés par les contemporains ? L’insomnie, le somnambulisme peuvent-ils se lire dans les écrits considérés, à l’époque, comme de la sorcellerie ?