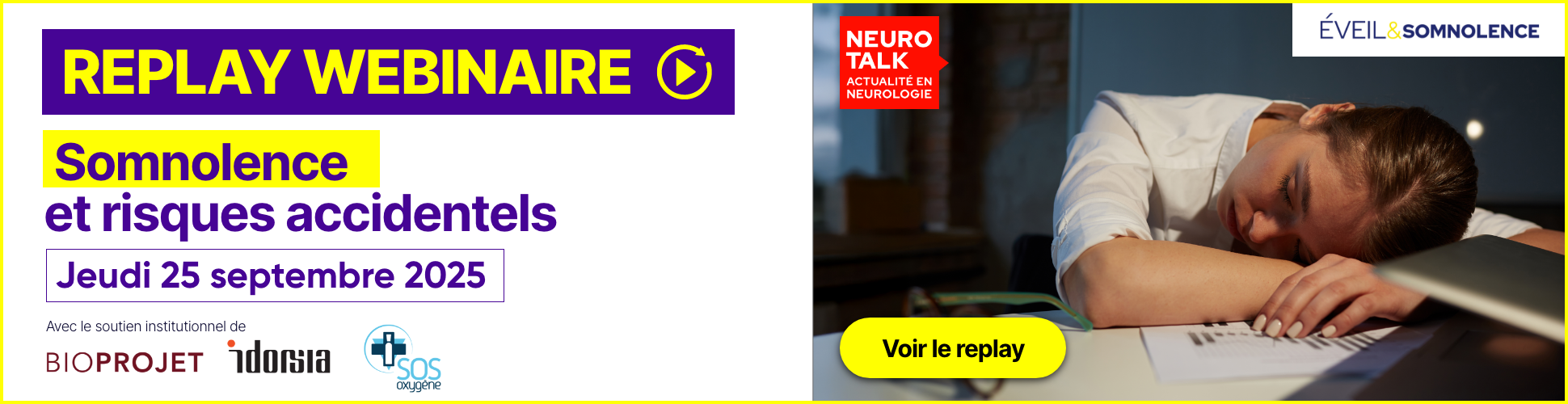La somnolence au volant est l’une des premières causes d’accident de la route. Avec la consommation d’alcool et la vitesse, elle est une des principales causes d’accidents mortels sur autoroute. De plus, la somnolence au volant est fréquente : 9 % des conducteurs déclarent avoir au moins un épisode par mois de somnolence au volant. Il est donc risqué de prendre la route avec un manque de sommeil, surtout pour certains patients ayant un syndrome d’apnées du sommeil (SAS) (même si la somnolence n’est pas systématique dans cette pathologie), car le risque d’accident est deux fois plus important que chez les conducteurs sans SAOS. Chez les patients bien traités avec un appareil de ventilation, ce risque revient à la normale, mais de 6 à 13 % des patients restent somnolents 1 .
DÉFINITION DE LA SOMNOLENCE
État d’éveil physiologique abaissé, propension à l’assoupissement, avec une incapacité à rester éveillé.
La somnolence est à différencier de la fatigue, qui est un épuisement progressif des ressources cognitives et physiques, avec diminution des performances.
LES CAUSES DE LA SOMNOLENCE
COMPORTEMENTALE
- Privation de sommeil
- Horaires de travail irréguliers, de nuit, ou postés
SECONDAIRE À UNE AFFECTION MÉDICALE
- Troubles du sommeil :
– troubles respiratoires (syndrome d’apnées du sommeil),
– troubles moteurs du sommeil (syndrome des jambes sans repos, parasomnies comme le somnambulisme),
– hypersomnolence d’origine centrale (narcolepsie de type 1 et 2, hypersomnie idiopathique). - Pathologies médicales chroniques (neurologiques, infectieuses, métaboliques, psychiatriques, endocriniennes, etc.)
IATROGÈNE
- Prise d’un médicament psychotrope
- Prise d’une substance
- Prise d’une molécule avec un effet neurologique central (benzodiazépines, somnifères, alcool, can- nabis, etc.)
3 % des accidents de la route seraient dus à la prise de médicaments psychotropes, les conducteurs qui consomment
des benzodiazépines ont un risque accidentel deux fois plus élevé que les conducteurs qui n’en consomment pas.
COMMENT MESURER LA SOMNOLENCE ?
1. DE FAÇON SUBJECTIVE : DÉPISTAGE
• Échelle de somnolence d’Epworth (cf. p.5) : un autoquestionnaire évaluant la probabilité de somnoler dans huit situations de la vie quotidienne.
Un score > 10 indique une plainte de somnolence diurne excessive.
• Question précise : « Avez-vous déjà conduit dans l’année précédente en souffrant de somnolence au point de rendre la conduite pénible, de réaliser des franchissements de ligne ou de devoir vous arrêter ? »
→ Risque accidentel × 10 si le conducteur répond oui à cette question 2 .
2. DE FAÇON OBJECTIVE : DEUX TESTS VALIDÉS
• Le test itératif de latence d’endormissement (TILE) : mesure la capacité à s’endormir sur cinq périodes de 20 minutes espacées de 2 heures, allongé dans un lit dans l’obscurité.
– Le patient a pour consigne de ne pas lutter contre le sommeil. On mesure la latence d’endormissement moyenne sur les 4 sessions (somnolence pathologique si ≤ 8 minutes, test développé initialement pour diagnostiquer la narcolepsie).
– Conditions de réalisation du test : dans un laboratoire du sommeil, sans aucun traitement médicamenteux pouvant avoir une influence sur le sommeil, et après une nuit de sommeil enregistrée avec au moins 6 heures de sommeil.
Il existe une relation entre la somnolence mesurée par le TILE et le risque de survenue d’accident de la route. Cependant, la motivation du patient peut fausser le résultat : si jamais il lutte contre la somnolence, celle-ci peut être sous-estimée.
• Le test de maintien d’éveil (TME) :
mesure la capacité du sujet à résister à l’endormissement, dans la journée, sur 4 périodes de 40 minutes espacées de 2 heures, assis dans un lit ou un fauteuil dans une chambre semi-obscure.
– Le patient a pour consigne de rester éveillé.
On mesure la latence d’endormissement moyenne sur les cinq sessions (si ≤ à 33 minutes : somnolence modérée ; si ≤ à 19 minutes : surrisque d’accident de la route).
– Conditions de réalisation du test :
dans un laboratoire du sommeil, après une nuit de sommeil enregistrée avec au moins 6 heures de sommeil. Contrairement au TILE, il est possible de réaliser le TME avec un traitement médicamenteux éveillant, ou un appareillage de ventilation en cas de SAS, pour contrôler l’efficacité d’une prise en charge.
Il existe une relation entre la somnolence mesurée par le TME et le risque d’accident. Le TME serait moins falsifiable que le TILE, plus apte à évaluer le risque potentiel de somnolence au volant. Il s’agit d’un marqueur objectif adapté pour évaluer la somnolence dans le contexte de l’évaluation médico-légale du risque accidentel à la conduite automobile.
ASPECT MÉDICO-LÉGAL
L’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 dresse une liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou permettant la délivrance de permis à durée de validité limitée.
La somnolence diurne excessive (et toutes ses causes) appartient à cette liste.
TO-DO LIST
- Le médecin généraliste doit informer son patient atteint d’une des affections listées de la nécessité de prévenir l’autorité préfectorale.
- C’est alors au conducteur de se soumettre à un contrôle médical agréé, de sa propre initiative.
- Les médecins généralistes sont soumis au secret professionnel et ne peuvent donc pas signaler les conducteurs à risque.
- L’entourage d’un patient peut signaler à la préfecture le conducteur à risque.
- Le médecin doit pouvoir apporter la preuve, par tout moyen, qu’il a informé son patient et qu’il a tout fait pour le convaincre de déclarer sa pathologie.
LES DEUX CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
GROUPE LÉGER – GROUPE 1 :
Catégories A, A1, A2, B1, B, BE (motocyclettes avec ou sans sidecar, tricycles, véhicules automobiles) : permis de conduire à des fins NON professionnelles
→ Pas d’obligation de TME, mais :
- le médecin spécialiste qui prend en charge la somnolence décide des investigations, en fonction de son évaluation clinique : il peut donc demander un TME s’il le juge nécessaire,
- le médecin agréé ou la commission médicale pourront aussi demander parfois un TME, s’ils le jugent nécessaire
- et l’aptitude à la conduite est autorisée à titre temporaire : 3 ans (en l’absence de modification de la symptomatologie et/ou de la prise en charge, et/ou avis médical contraire).
GROUPE LOURD – GROUPE 2 :
Catégories C1, C, CE, D1, D1E, D, DE, chauffeurs professionnels de catégorie B, conduite des taxis, voitures de remise, ambulances, véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou transport public des personnes, enseignants de la conduite
→ Obligation de TME :
- le médecin agréé ou la commission médicale considéreront le TME pour évaluer l’aptitude à la conduite automobile,
- l’aptitude à la conduite est autorisée à titre temporaire : 1 an (en l’absence de modification de la symptomatologie et/ou de la prise en charge, et/ou avis médical contraire)
- et le médecin du travail doit évaluer les risques additionnels en lien avec les conditions.