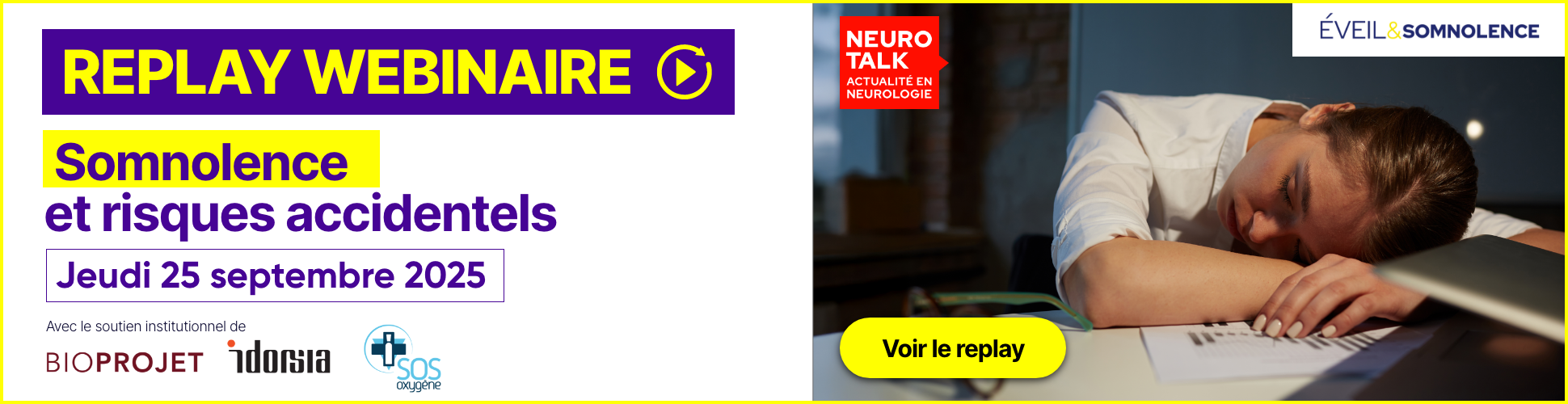GÉNÉRALITÉS ET DIAGNOSTIC
Une insomnie est une incapacité à plonger dans le sommeil, même quand les conditions sont propices à un endormissement. Cette résistance se retrouve dans l’étymologie même du mot : du latin « somnus » (le sommeil) accompagné du préfixe privateur « in ».
L’insomnie peut se caractériser par des difficultés d’endormissement ou de maintien du sommeil avec, par exemple, des réveils intra-sommeil, un réveil prématuré et une incapacité à se rendormir. Isolée, une insomnie reste bénigne et n’aura qu’un impact faible sur l’individu ayant ainsi mal dormi. Toutefois, elle devient problématique lorsqu’elle se répète sur la durée.
Le diagnostic d’insomnie chronique doit être posé quand le patient est sujet à ce trouble au moins trois nuits par semaine, pendant au moins 3 mois, avec un retentissement dans la journée, et ce malgré des conditions adéquates à l’endormissement. La version la plus récente de la classification internationale des pathologies du sommeil (ICSD-3) rappelle qu’il est important de s’assurer que ces privations de sommeil ne puissent pas s’expliquer par un manque d’occasion de dormir ou un contexte inadapté au sommeil (absence d’un environnement sûr, calme, sombre et confortable). Le diagnostic d’insomnie chronique implique également que les plaintes rapportées concernant un mauvais sommeil ne dé- coulent pas d’une autre pathologie affectant l’alternance veille-sommeil (narcolepsie, troubles respiratoires, etc.) ou des effets relatifs à certaines substances. Le diagnostic ne s’applique pas non plus aux “petits dormeurs” n’ayant aucune difficulté à s’endormir ou à rester endormis, mais qui s’inquiètent de la brièveté de leur nuit.
70 % des personnes souffrant d’insomnie à un moment donné continuent de présenter des symptômes 1 an plus tard.
Source : ICSD-3
ÉPIDÉMIOLOGIE
L’insomnie est la pathologie du sommeil la plus fréquemment diagnostiquée puisqu’elle affecte environ un dixième de la population occidentale (Europe et États-Unis), d’après l’American Association of Sleep Society (AASM). Les chiffres exacts varient en fonction des critères diagnostiques employés, des pays observés et des études réalisées. Ainsi, 10 à 20 % de la population française souffrirait de ce trouble. Cette prévalence diminue jusqu’à 7 % en Italie, tandis que certains travaux menés au Canada indiquent que plus de 23 % de la population souffrirait d’insomnie. Même si cette pathologie peut affecter toutes les classes d’âge (à partir de 6 mois), son incidence augmente avec les années. La prévalence est par ailleurs plus élevée chez les femmes et les personnes issues de classes sociales défavorisées. L’Inserm liste des faits comme vivre seul, être sans emploi et souffrir de maladie(s) chronique(s) comme des facteurs de risque supplémentaires de souffrir d’insomnie chronique.
La cinquième version du DSM indique qu’une plus grande prévalence de l’insomnie est constatée chez les jumeaux homozygotes par rapport aux jumeaux dizygotes. Ces résultats concordent avec des études épidémiologiques menées dans des cohortes de familles suggérant une part d’héritabilité de l’insomnie. À ce jour, aucun gène précis n’a pu être clairement identifié. Une exception concerne l’insomnie familiale fatale, une pathologie rare caractérisée par une perte neuronale sévère liée à une mutation du gène de la protéine prion.
UNE MALADIE COMPLEXE
L’insomnie chronique n’affecte pas uniquement les nuits des patients qui en souffrent, mais bel et bien leurs journées entières. Avec des répercussions sur les états d’éveil, les insomniaques se plaignent ainsi de fatigue, d’irritabilité diurne ainsi que de baisses de la concentration. Les nuits blanches qui s’enchaînent sont associées à une augmentation du taux d’accident et de l’absentéisme, et à une diminution de la productivité et de la qualité de vie en général. Les symptômes somatiques découlant d’un mauvais sommeil incluent notamment des céphalées ainsi que des troubles gastro-intestinaux. Par ailleurs, l’ICSD-3 indique que l’insomnie est une comorbidité courante de pathologies médicales courantes comme le diabète, l’arthrose ou la fibromyalgie. Les intrications entre ces affections peuvent être complexes puisque l’insomnie peut augmenter le risque d’affections médicales et à l’inverse, les problèmes médicaux majorent le risque d’insomnie. Cette relation à double sens est également retrouvée avec la dépression et l’anxiété. L’Inserm estime ainsi que les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression auraient 7 à 10 fois plus de risque de souffrir d’insomnie chronique que les autres. Enfin, le DSM relève des usages abusifs de médicaments, de stimulants et d’alcool chez les insomniaques cherchant à combattre les effets de l’insomnie.
INSOMNIES ET COVID
Le contexte de pandémie virale et d’état d’urgence sanitaire a engendré une recrudescence des cas d’insomnie dans la population générale. Une étude publiée en octobre 2022 dans le Journal of Sleep Research a notamment analysé, en population générale, des données de plus de 1 500 individus suite au premier confinement. Parmi eux, plus de 50 % ont souffert de symptômes d’insomnie légère à sévère au cours de cette période. Ces troubles de sommeil étaient notamment corrélées au fait d’avoir un espace de vie restreint.
Au-delà du stress généré par la situation de pandémie, on observe une plus grande prévalence des problèmes de sommeil chez les personnes infectées par le Covid-19, même plusieurs mois après le diagnostic. Cette relation entre insomnie et Covid-19 est bidirectionnelle puisque les personnes souffrant de problèmes de sommeil présentent des risques plus élevés d’être infectées par le Covid-19.
APPARITION ET PERSISTANCE DE L’INSOMNIE
Les premières perturbations du sommeil surviennent généralement à la suite d’un événement marquant (séparation, deuil, changement professionnel) ou au cours d’une période de stress chronique. Chez la majorité des personnes, le rythme de sommeil normal est retrouvé naturellement avec le temps et l’insomnie transitoire disparaît. En revanche, certains sujets commencent à éprouver des difficultés de sommeil persistantes. L’insomnie chronique se développe de façon préférentielle chez les personnes anxieuses ou promptes à l’inquiétude. Un cycle vicieux se met alors en place et les patients souffrant d’insomnies développent une préoccupation excessive vis-à-vis de leur sommeil et des conséquences diurnes de leurs mauvaises nuits. Ces inquiétudes peuvent s’amplifier quand l’heure du coucher approche. Ainsi, l’ICSD-3 mentionne qu’à l’inverse des bons dormeurs, les insomniaques expriment l’intention consciente et un effort excessif pour dormir. De plus, ces patients sous-estiment la durée réelle de leur sommeil et à l’inverse surestiment leur latence d’endormissement. Ce rapport au sommeil déformé favorise alors la chronicité de l’insomnie, sans qu’aucune atteinte cérébrale structurelle ne soit détectée chez la majorité des sujets insomniaques.
83 % des patients ayant suivi une TCC ont significativement réduit la sévérité de leur insomnie.
Source : ThéraSomnia
TRAITEMENTS : RETROUVER UNE RELATION SAINE AVEC SON SOMMEIL
Les traitements mis en place pour prendre en charge une insomnie ont deux objectifs. D’une part, ils visent à réduire les symptômes nocturnes et d’autre part à améliorer la qualité de vie diurne. Actuellement, des solutions médicamenteuses, comme les benzodiazépines, existent, mais ne constituent pas la meilleure option dans le traitement d’une insomnie chronique. Malgré un effet rapide sur les symptômes nocturnes, les hypnotiques ne doivent pas être employés de façon prolongée (< 4 semaines) afin d’éviter une accoutumance psychologique et/ ou une dépendance physiologique. Ces traitements s’accompagnent également de somnolences observées le lendemain matin et de chutes chez les personnes âgées notamment.
Les recommandations indiquent que le traitement de première intention est la thérapie cognitive comportementale (TCC). Cette approche thérapeutique vise à rationnaliser les pensées des patients insomniaques et de leur inculquer les comportements appropriés vis-à-vis de leurs nuits. Plus difficiles à mettre en place, les TCC sont pourtant plus efficaces sur le long terme et ont des effets secondaires minimes. Elles participent également au sevrage médicamenteux des patients devenus dépendants de leurs somnifères.
Pour être diagnostiquée comme chronique, une insomnie doit se déclarer au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois.
1 Français sur 5 souffre d’insomnie Source : Institut national du sommeil et de la vigilance
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES À CONSULTER
- DSM-V
- ICSD-3
- Inserm (www.inserm.fr/dossier/insomnie/)
- Réseau Morphée (www.reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/insom-nies-apnees/insomnie)
- Institut National du Sommeil et de la Vigilance (www. institut-sommeil-vigilance.org/insomnie/)
- ThéraSomnia
- www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13752
- Taquet M, Geddes JR, Husain M, et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survi- vors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. Lancet Psychiatry 2021 ; 8 : 416-27.
- Kim H, Hegde S, LaFiura C, et al. COVID-19 illness in relation to sleep and burnout. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2021 ; 4.
- ahrami H, BaHammam AS, Bragazzi NL et al. Sleep problems during the COVID-19 pandemic by population: a systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med 2021 ; 17 : 299-313.
- Koffel E, Bramoweth AD, Ulmer CS. Increasing access to and utilization of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I): a narrative review. J Gen Intern Med 2018 ; 336 : 955-62.