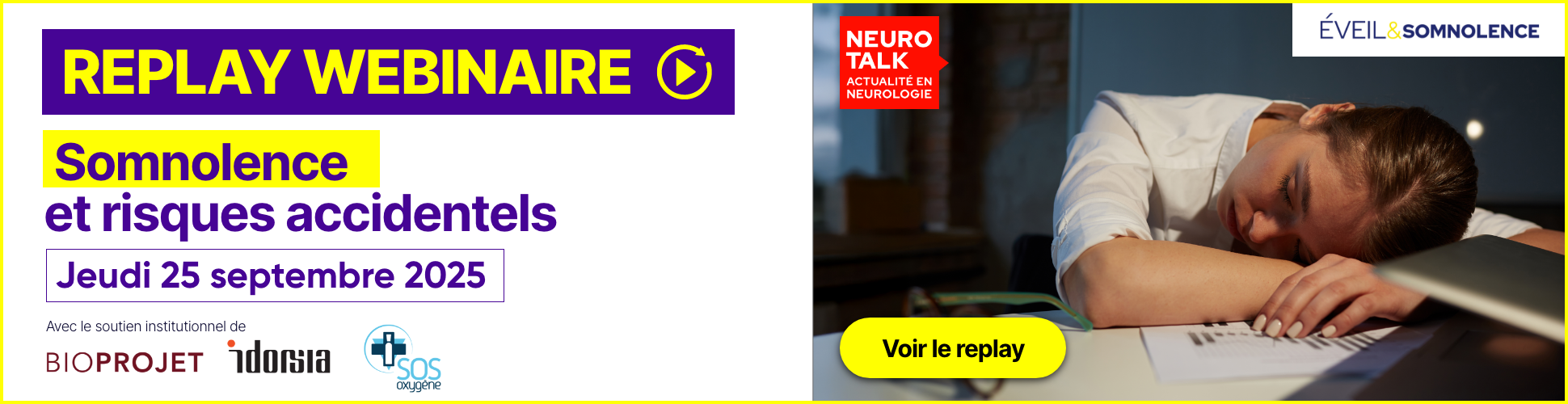Le diabète de type 1 est-il aussi concerné ?
EN SYNTHESE :
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est assez systématiquement recherché chez les patients diabétiques de type 2 (DT2), du fait notamment de l’insulinorésistance favorisée par l’obésité. Il l’est en revanche rarement dans le diabète de type 1 (DT1). S’il est possible d’estimer, avec l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INVS), que 50 à 70 % des patients diabétiques de type 2 présenteraient une perturbation de l’architecture du sommeil [1], et qu’un tiers serait traité pour un SAS [2, 3], ces précisions manquent pour le DT1. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’étude épidémiologique d’envergure sur ce sujet. Pourtant, une perturbation de l’architecture du sommeil a été rapportée dans le DT1 dès 1985 [4], et des mécanismes physiopathologiques spécifiques pourraient être invoqués, notamment à l’aune de la neuropathie. En outre, la prévalence de l’obésité croît régulièrement dans la population générale, une obésité qui pourrait dès lors toucher aussi le DT1. Depuis la publication princeps de 1985, d’autres travaux concernant le SAS dans le DT1 ont été publiés. Ainsi, nous proposons de prendre appui sur la littérature disponible pour nous forger une opinion sur cette problématique de santé.
Les données disponibles concernant le SAS dans le DT1
Étonnamment, en première instance, les études disponibles (Tab. 1) font apparaître dans le DT1 une fréquence du SAS importante ou même très importante [5-11].
Les chiffres présentés doivent, certes, être interprétés avec une certaine prudence, pour la double raison des effectifs d’études assez grêles et de la méthodologie variable des moyens diagnostiques. Il n’y a cependant pas de biais diagnostique qui tiendrait à l’investigation diagnostique guidée par la symptomatologie du SAS – nous allons en effet voir que les patients sont au contraire asymptomatiques.
Nous retiendrons en particulier les observations faites avec le « critère dur » qu’est la polysomnographie. Pour ce qui nous concerne [11], nous avons rapporté un nombre d’apnées-hypopnées par heure (IAH) supérieur à cinq dans un peu plus du tiers de notre population ; Manin et al. montrent même une proportion de près de 50 % de leur patientèle avec un IAH > 10 [9].
Nous avons aussi comparé nos données dans le DT1 avec ce qui a été observé dans la plus grande enquête épidémiologique dans la population générale réalisée aux États-Unis et publiée en 2013 [12] – une étude donc publiée plus anciennement que la nôtre, mais émanant d’un pays dont on connaît la forte prévalence de l’obésité.
Nous avons pris un même critère pour comparer ces deux études, en l’occurrence celui d’un SAS modéré à sévère, et noté ainsi une fréquence près de quatre fois plus élevée dans notre effectif, comparativement à celle notée en population générale (respectivement 17,4 et 4,6 %).
Une telle proportion pour notre étude fera légitimement s’interroger sur la possible responsabilité du surpoids et de l’obésité quand il s’agira d’évoquer les mécanismes en cause.
La lecture de cet article est réservée aux abonnés.
Pour accéder à l'article complet
Découvrez nos offres d'abonnement
Abonnez-vous à la revue et accédez à tous les contenus du site !
- Tous les contenus de la revue en illimité
- Les numéros papier sur l'année
- Les newsletters mensuelles
- Les archives numériques en ligne
ou
Inscrivez-vous gratuitement sur Éveil & Somnolence.fr et bénéficiez de l'accès à de nombreuses catégories du site !
- Accès aux catégories d'articles exclusives
- Les newsletters mensuelles
- Votre historique de commandes en ligne