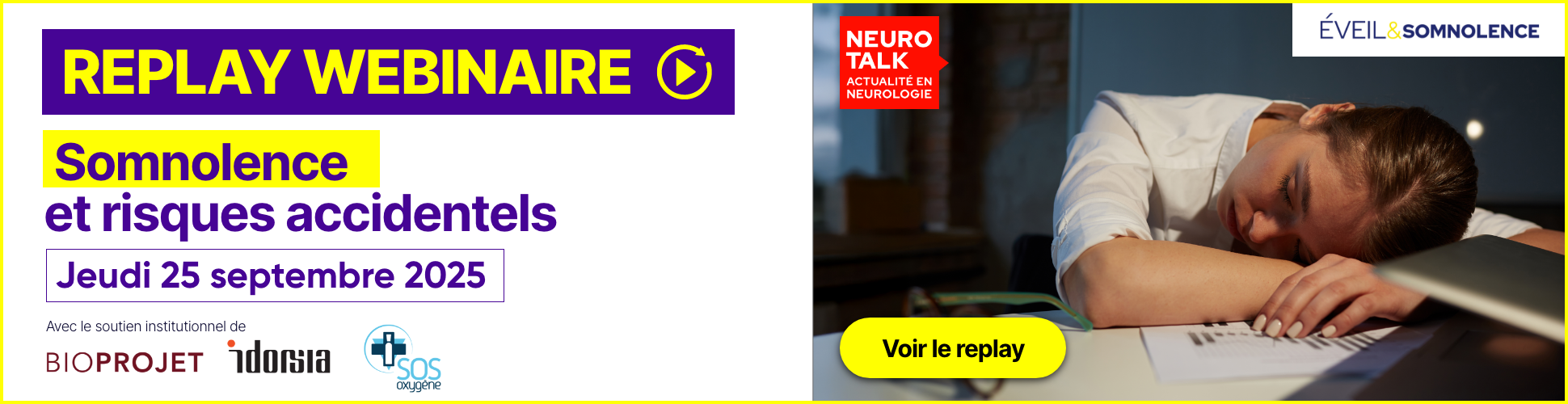Des patients bien traités mais toujours somnolents
La somnolence est l’un des symptômes du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) considéré souvent comme LE maître symptôme. Selon Gasa et al., il n’est pourtant présent que chez 57,5 % des patients environ [1]. Dans ce même article, la somnolence sous pression positive continue (PPC) était observée chez 13 % des patients traités par PPC : persistante pour 18,3 % d’entre eux, émergeante pour 5,6 %.
Des patients bien traités ?
La prise en charge d’une telle somnolence repose en premier lieu sur l’assurance d’un traitement par PPC optimal :
– une bonne observance. Celle-ci doit être suffisante en termes de temps d’utilisation, elle doit se rapprocher le plus possible du temps total de sommeil du patient. Elle doit être également régulière, quotidienne. Plus on utilise la PPC, moins on est somnolent [2] ;
– un traitement efficace :
• des effets indésirables gérés : problèmes d’interface, de fuites, de sécheresse nasale/buccale, de pressions, d’aérophagie/météorisme… ;
• un index d’apnées/hypopnées sous PPC (IAHdébit) normalisé. Mais il est important de ne pas prendre ce paramètre comme indiscutable. Il a été retrouvé que 28,4 % des patients étaient considérés comme bien contrôlés alors que l’IAHPSG était supérieur à 5/h. À l’inverse, 7 % des patients considérés comme non contrôlés avaient un IAHPSG inférieur à 5/h [3].
Pour ce faire, il est important d’aller au-delà des statistiques calculées sur plusieurs jours/mois par le logiciel de la machine. Aujourd’hui, quelle que soit la PPC utilisée, il est possible de consulter les données détaillées (profils nocturnes quotidiens) et surtout les courbes de débit vous permettant d’interpréter par vous-même le signal de la machine. En cas de doute, un enregistrement poly-(somno)graphique sous PPC sera demandé.
Enfin, il est important de rechercher les facteurs de déstabilisation tels qu’une prise de poids, d’alcool, de médicaments, la survenue de pathologies cardiovasculaires (AVC/IDM/troubles du rythme cardiaque…).
Quelles pathologies rechercher ?
Il est indispensable de caractériser au mieux cette hypersomnolence, « concept sémiologique aux multiples dimensions », s’associe-t-elle à une quantité excessive de sommeil, à des perturbations du réveil…[4], quels signes cliniques associés ?
Les deux diagnostics les plus fréquemment retrouvés
– La dette de sommeil chronique facilement identifiable à l’interrogatoire, avec l’aide d’un agenda de sommeil, d’une actimétrie.
– Un trouble de l’humeur avec, en chef de file, la dépression.
Quelles autres pathologies neurologiques rechercher ?
– Narcolepsie et hypersomnie idiopathique (qu’elles soient « primaires » ou secondaires à une myopathie de Steinert, une maladie de Parkinson…).
– Mouvements périodiques de jambes éveillant.
– Syndrome des jambes sans repos (un tiers des patients sont somnolents).
– Parasomnies du sommeil lent profond (45 % d’entre eux présentent une somnolence).
Leurs diagnostic et implication dans la somnolence du patient nécessiteront un bilan polysomnographique avec vidéo associée à des tests itératifs de latence d’endormissement ± sommeil ad libitum.
Comment évaluer la somnolence et son incidence sur la vigilance ?
Le score d’Epworth, test pratique, largement utilisé, a pourtant une performance diagnostique toute relative : sensibilité de 55,6 %, spécificité de 84,8 %. Plusieurs hypothèses sont avancées : anosognosie, système de compensation, éveil local durant le sommeil ou sommeil local durant la veille.
Au laboratoire du sommeil, nous disposons principalement de deux tests.
Les tests itératifs de latence d’endormissent (TILE) : il s’agit de cinq tests de 20 minutes, espacés de 2 heures. Le patient est allongé, dans l’obscurité, avec la consigne de se laisser aller au sommeil. La normale est supérieure à 8 minutes.
Le test en miroir permettant d’apprécier la vigilance. Les tests de maintien d’éveil : ils comprennent quatre tests de 40 minutes, espacés de 2 heures, patient assis ou semi-allongé avec comme consigne de rester éveillé. La latence moyenne normale est supérieure à 19 minutes. En cas de conduite professionnelle, cette latence doit être supérieure à 33 minutes.
Les TILE ne sont pas obligatoires pour affirmer le diagnostic de SDEr mais sont néanmoins fortement recommandés en cas de suspicion d’hypersomnolence centrale, et très utiles en cas de doute clinique (interrogatoire non fiable, troubles du sommeil concomitants, IAH peu sévère au moment du diagnostic).
Quelle solution pour des patients somnolents bien traités par PPC après exclusion d’une pathologie associée nécessitant une prise en charge et un traitement spécifique ?
Aujourd’hui, deux molécules ont une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de la somnolence résiduelle sous PPC : le solriamfétol et le pitolisant. Ces médicaments sont soumis à prescription initiale hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie (solriamfétol), en pneumologie ou titulaires de la Formation spécifique transversale (FST) et aux médecins exerçant dans les centres du sommeil. À noter : vigilance en cas de comorbidités psychiatriques (avis d’un psychiatre recommandé pour vérifier la stabilité des troubles et assurer une prise en charge optimale) et attention particulière de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque avec le solriamfétol.
Des recommandations pour le bilan et la prise en charge de la somnolence résiduelle du SAHOS ont été publiées très récemment dans la revue Médecine du Sommeil, résultant d’un consensus de la Société française de recherche et médecine du sommeil (SFRMS) et de la Société de pneumologie de langue française (SPLF) [5].
Cas clinique
Patient de 50 ans, conducteur SNCF, adressé pour somnolence, ronflements et pauses décrites, évoluant depuis 2 ans. Antécédents : rhinite allergique (suivie ORL régulier), adénoïdectomie, amygdalectomie, intervention sur les os propres du nez.
Aucun traitement.
Score d’Epworth : 13/24.
Somnolence en situation active : 0/12.
Diagnostic : syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil sévère, importante fragmentation du sommeil, facteur positionnel (Fig. 1).
Traitement
3 Échec d’un traitement positionnel.
3 Mise en place d’un appareillage par PPC en autopilotée (5-12 cmH2O), associée à un humidificateur et un masque facial (échec du masque nasal).
Bilan clinique à 3 mois
Le patient se sent moins somnolent, mais note parfois des retraits du masque en cours de nuit sans aucun souvenir.
Données « machine » :
Observance moyenne de 3,3 h/j avec des retraits automatiques en cours de nuit.
Pression 95e centile = 7,6 cmH2O.
Fuites 95e centile = 13,2 l/min.
IAHdébit = 1,5/h.
Contrôle des tests de maintien d’éveil (TME)
La latence moyenne d’endormissement a été calculée à 12 minutes, incompatible avec la reprise de la conduite qu’elle soit professionnelle ou non.
Décision d’un bilan 48 heures devant la persistance d’une vigilance anormale sous PPC (Fig. 2)
3 Tests itératifs de latence d’endormissement à 8,5 minutes.
3 Absence d’endormissement en sommeil paradoxal.
3 Absence d’allongement du temps total de sommeil sur 24 heures (7 heures 42 minutes).
3 IAH bien corrigé sous PPC.
3 Absence de mouvement périodique de jambe.
3 Insomnie de maintien avec nombreux éveils et micro-éveils spontanés (pas de cause retrouvée) et difficulté à consolider le sommeil en début de nuit. La deuxième nuit est de meilleure efficacité mais persistent de nombreux éveils et micro-éveils spontanés.
Ce bilan conclut à l’absence d’une hypersomnie centrale associée, confirme le bon contrôle du syndrome d’apnées du sommeil par la PPC, mais authentifie la persistance d’une fragmentation du sommeil importante.
Décision thérapeutique
Poursuite de la PPC, introduction de mélatonine et d’une molécule éveillante.
Nouveau contrôle polysomnographique et TME :
Normalisation de l’efficacité du sommeil, IAH = 2,5/h. Quatre éveils en ondes lentes en sommeil lent profond (touche le masque, le tuyau) pouvant expliquer les retraits automatiques du masque constatés par le patient. Tests de maintien d’éveil toujours pathologiques avec une latence calculée à 16 minutes.
Une somnolence rebelle !
La « quête étiologique » d’une somnolence est parfois difficile, mettant souvent en évidence l’intrication de plusieurs facteurs. L’adaptation du(des) traitement(s) peut être longue et la vérification de son efficacité indispensable.
Pour ce patient, une orthèse mandibulaire est en cours de confection parallèlement à la poursuite de la mélatonine et l’introduction d’une autre molécule éveillante.